
Accueil > Les rubriques > Cerveau > Logiconochronie — VI
Logiconochronie — VI
Sur les Méditations métaphysiques de Descartes lues à l’aune de considérations sur la tromperie
,
S’orienter, choisir, décider... et recommencer...
tels sont les actes qui éternellement inchoatifs sont tout aussi éternellement embarqués dans la mécanique incessante de la succession qui constitue le moteur irréfutable de la concaténation et d’où, grands veneurs tardifs, nous établissons que la seule instance aussi éternelle capable de produire ces miracles en chaîne est, évidemment, celui que nous sommes et nommons avec l’assurance de ceux qui ne se trompent jamais puisque c’est eux et d’eux qu’ils parlent : le sujet.
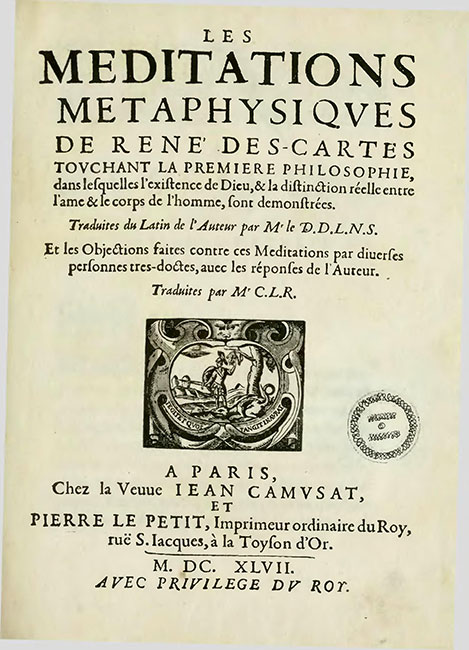
Loup y es-tu ?
On pourrait croire que cette instance si assurée d’elle-même, l’est à la fois en ce qu’elle passe à ses propres yeux pour « être » l’auteur de la définition que par transmission culturelle actualisée en chacun, elle lui permet de posséder de lui-même et en ce qu’elle dispose d’autant de preuves que nécessaire pour démontrer son existence depuis des temps sinon immémoriaux, du moins suffisamment anciens pour faire autorité.
Le sujet est cette instance que chacun de nous peut et doit croire « être » s’il veut pouvoir et prétendre continuer à vivre dans ce monde sujet de la cohérence duquel, bien qu’il s’en reconnaisse l’auteur, il commence à douter.
Il commence ? Disons plutôt qu’il ne parvient guère à s’y autoriser encore lors même que de toutes part le bateau prenant l’eau, il ne peut continuer à faire semblant d’ignorer qu’il a les pieds mouillés. Mais le bateau étant à la fois le sujet et le monde dont il se croit le maître parce qu’il s’en prétend l’auteur, il a du mal à accepter, – diantre, à reconnaître ! – que ce dont il devrait se défaire au plus vite, lui-même donc, il ne parvient au mieux qu’à commencer d’en douter.
Fidèles à une de ces histoires que la tradition nous propose, nous bouchons nos oreilles aux chants des sirènes, incapables de comprendre que, sirènes de l’urgence elles ne cessent de trompeter à nos oreilles sous la forme de cris stridents émis par des cornes de brume lascivement trompeuses et brutalement perverses, des conseils vitaux devant nous permettre de changer de cap et ce faisant de ne pas nous perdre dans l’océan brumeux de nos croyances disponibles certes, mais tellement embrouillées.
Les écouterions-nous, nous ne saurions sans doute pas « répondre » aux messages qu’elles nous adressent, tout peuplés que nous savons qu’ils sont d’ordres impraticables sinon au prix d’une mutation psychique dont nous nous sentons incapables. Et encore plus si elle doit avoir lieu, là, maintenant !
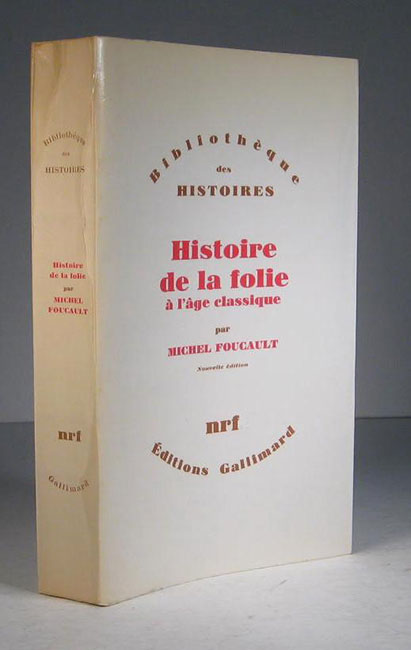
Les fuyons-nous, nous les entendons encore mais alors, c’est avec la conviction que nous faisons bien que nous nous bouchons les oreilles, redoublant notre surdité psychique foncière d’une surdité jouée, de celle qui font qu’enfants jouant au loup nous tendions l’oreille pour entendre ses pas souhaitant à la fois et en même temps lui échapper et qu’il nous trouve pour nous dévorer et cessions de l’entendre approcher tant nous commencions soudain de croire que le jeu n’en était plus un.
Ce petit chariot de métaphores éculées n’a d’autre fonction que de mettre en scène cette instance que nous sommes et que nous nommons selon les moments, « sujet » ou « conscience », l’un prenant inconsidérément la forme de l’autre, et l’autre, par le jeu de l’intermittence, se posant comme la structure portante de l’un.
Donc, la cohérence des significations dont nous peuplons nos existences, dépend, comme nous le croyons et le pensons de façon mêlée, et repose sur les décisions du sujet. Nous en savons quelque chose puisque nous en sommes un et nous savons aussi – comment cela pourrait-il en être autrement ? – que ce sujet dont nous sommes l’un des représentants, et qui en tant que « tel » vaut pour les autres comme les autres valent pour nous, existe en quelque sorte de toute éternité, entendons depuis que l’homme est homme ou presque, le presque nous renvoyant à l’aube cosmique de la préhistoire, en ces temps où, sans doute, ceux qui nous ont précédé ne jouissaient pas encore de toutes les miraculeuses capacités et facultés dont nous jouissons aujourd’hui.
Ainsi, du temps d’Homère par exemple et jusqu’à nous sans interruption, ce sujet est-il le maître en sa demeure, même si parfois cette domination est contestée ? Sur ce point pas de doute ! Par qui ou quoi tel reste le problème qui n’a à ce jour pas été tranché, même si finalement un nom domine à travers siècles ?
Et pourtant nombreux sont ceux qui ont douté ! Et nombreux sont ceux qui ont affirmé connaître le fauteur de troubles. On connaît la réponse : le diable probablement !
Une « folle » querelle : Foucault, Derrida, Descartes
Une querelle est née entre deux monstres de la philosophie française du XXe siècle dans les années soixante à propos d’une lecture des Méditations de Descartes proposée dans L’histoire de la folie à l’âge classique par Foucault, livre paru en 1961, et critiqué pied à pied par Derrida dans un long article, « Cogito et histoire de la folie », conférence de 1963, publiée dans L’écriture et la différence en 1967.
Au cœur du débat, la question singulière du statut de la folie dans cette œuvre de Descartes qui évoque dès la première méditation, le risque que la folie pourrait faire courir à celui qui médite qu’il se perde et avec lui toute possibilité de penser et de croire. Mais on le sait, il rejette le fait que la folie soit susceptible de mettre en cause le pouvoir de contrôle que le sujet exerce de droit sur lui-même, sur la connaissance et sur la réalité au moyen de la raison. Il faut cependant parvenir à rendre la possibilité de ce contrôle indubitable. Il s’agit de fonder dans le mouvement même de l’affirmation du « je pense », la possibilité d’une certitude et l’impossibilité d’une tromperie.
Si la folie fait irruption dans ce débat, c’est évidemment à cause non seulement du titre du livre de Foucault mais du texte de la première méditation qui semble mettre le risque de la folie au cœur de l’enjeu de la fondation du sujet comme sujet pensant. Foucault voit dans une remarque de Descartes l’établissement d’une ligne de partage nette entre raison et folie. Descartes écrit en effet dès le quatrième paragraphe de la première méditation : « Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi ? Si ce n’est peut-être que je me compare à ces insensés, de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, qu’ils assurent constamment qu’ils sont des rois, lorsqu’ils sont très pauvres, qu’il sont vêtus d’or et de pourpre, lorsqu’ils sont tout nus ; ou s’imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Mais quoi ? Ce sont des fous et je ne serais pas moins extravagant, si je me réglais sur leur exemple. »
Or, écrit Foucault, « cette certitude, Descartes maintenant l’a acquise, et la tient solidement ; la folie ne peut plus le concerner... Désormais la folie est exilée. Si l’homme peut toujours être fou, la pensée, comme exercice de la souveraineté d’un sujet qui se met en devoir de percevoir le vrai, ne peut pas être insensée. [1]. »
Cependant, ce que Foucault tente, c’est de penser la folie comme un enjeu socio-historique, ce qui permettrait de se défaire de la prégnance du modèle philosophique qui rapporte la question de la folie à la seule intériorité du sujet.
Dans un texte de 1972, « Mon corps, ce papier, ce feu », Foucault revient sur cette querelle et écrit : « Quant à l’étendue du leurre, le malin génie, c’est vrai ne le cède pas à la folie ; mais quant à la position du sujet par rapport au leurre, malin génie et démence s’opposent rigoureusement. Si le malin génie reprend les puissances de la folie, c’est après que l’exercice de la méditation a exclu le risque d’être fou [2]). »
Dans un autre texte de la même année intitulé « Réponse à Derrida », il conclut en interpellant Derrida qui, dit-il, « a voulu donner à cet événement la figure imaginaire d’un interlocuteur fictif, et totalement extérieur, dans la naïveté de son discours, à la philosophie. Par cette voix qu’il surimprime au texte, Derrida garantit au discours cartésien d’être clos à tout événement qui serait étranger à la grande intériorité de la philosophie. Et, comme messager de cet événement insolent, il imagine un bonhomme naïf, avec ses sottes objections, qui vient cogner à la porte du discours philosophique et qui se faite jeter dehors sans avoir pu entrer. » [3]. »
Pour Derrida l’enjeu de la querelle ne se situe pas autour de cette exclusion de la folie affirmée par Foucault. Au contraire, il ne voit dans le texte cartésien aucune exclusion mais plutôt l’aveu d’une difficulté majeure pour ne pas dire absolue, celle concernant la possibilité de fait et à jamais indépassable d’un risque de contamination de la raison par la folie. « Nous avons essayé de nous acquitter envers le geste par lequel Descartes s’acquitte lui-même à l’égard des puissances menaçantes de la folie comme origine adverse de la philosophie. » [4] »
Aussitôt après, conduisant le risque de la folie jusqu’à ses limites absolues et actuelles, il écrit : « Je ne philosophe que dans la terreur, mais dans la terreur avouée d’être fou. L’aveu est à la fois, dans son présent, oubli et dévoilement, protection et exposition : économie. [5] »
Si cette querelle a perdu de son intensité , c’est qu’une autre lecture est possible à la fois des enjeux de cette querelle et du texte cartésien. Ce qui apparaît aujourd’hui dans l’opposition entre Foucault et Derrida, c’est une question de topique et de rythmique : topique en ceci que s’opposent deux approches de l’espace de la pensée, et rythmique en ceci que s’opposent deux manières de lier les éléments et les registres de la pensée entre eux.
L’un met en place une approche de la folie à partir du grand dehors de la société et de ses pratiques concrètes. Et c’est ce grand dehors qui constitue pour lui le vecteur d’une critique radicale de la primauté du sujet qui se voit envahi par des figures de l’altérité provenant du corps social.
L’autre voit dans la folie le risque central qui déchire ou rature le cœur de toute philosophie puisque ce risque s’énonce dès ses commencements et est porté en héritage comme la figure d’un impossible et d’une impossibilité qui ne peut pas ne pas être. Le sujet trouve en son intériorité brisée, ou contestée, le signe même de sa dépendance à un risque qui le dépasse mais contre lequel, sujet de droit, il doit malgré tout pour exister, être comme immunisé.
Il apparaît donc que la folie joue un rôle de révélateur d’une tension dans le champ de la pensée qui peut et doit être reformulée. Repasser par Descartes est un bon moyen de reconsidérer l’enjeu de la tromperie dont la folie est en effet à la fois le nom acceptable et la figure hyperbolique incontournable.
Le paradoxe cartésien : intériorité psychique et extériorité divine
On considère Descartes comme le philosophe qui par son « Je pense, je suis », a donné au sujet, et pas seulement à la France, sa forme sinon définitive du moins la plus évidente et la plus emblématique à partir de laquelle s’est développée la philosophie du sujet qui fleurira au XIXe.
Chaque homme prononçant cette phrase, « je pense » est comme aimanté bien malgré lui à ce socle ontologique sur lequel se dresse la statue du sujet, mais de cet effet d’aspiration il semble qu’il en ressorte comme libéré de la psychose ontologique, cette angoisse devant l’instabilité des choses du monde, assuré qu’il serait, non pas de n’avoir plus à douter, mais au contraire de pouvoir le faire en toute sécurité.
Les Méditations ont semble-t-il conféré à l’acte de penser une dimension, un espace, un lieu ou du moins un milieu dans lequel il pouvait, le sujet pensant, exercer cette activité en toute confiance. Et c’est précisément là où le bât blesse. La confiance, jamais n’est acquise et plus que le risque de la folie, c’est l’absence de fondement de la « fiance » de la « fides » qui hante le sujet tel une érinye implacable.
Et c’est cette impossibilité d’une confiance qui constitue le ressort du sujet. Ce ressort n’est pas caché ou secret, mais il reste implicite et reste insaisissable par lui-même. Les philosophies du sujet sont toutes des stratégies de l’instance psychique désignée par le terme sujet, stratégie devant permettre, – mais pour combien de temps ? – de faire face à l’impossibilité de cette « fiance » qui le hante.
Et ce « danger », de s’apercevoir que la « fiance » est impossible, ou du moins instable, ou encore menacée dans sa continuité supposée ou revendiquée, en se révélant essentiellement formée de moments séparés, discrets, discontinus, ce danger est plus menaçant que tout autre danger, plus que la folie en tout cas. La folie est le nom de la projection déformante maximale de ce que le sujet prétend être ou tente d’être, et elle lui permet d’évacuer relativement aisément les questions qui, en effet, l’empêcheraient sinon de prétendre et de croire être ce qu’il croit et prétend être.
Au-delà de toutes les justifications qu’invente Descartes, ce qu’il cherche à prouver c’est que pour le « je pense », grâce à l’inversion de son reflet dans un œil d’or céleste, s’instaure une « fiance » sans faille, celle qui est rendue possible par le fait que Dieu assure la possibilité d’une continuité propre à rendre pérenne l’exercice de la pensée.
Dans une lettre de Descartes d’août 1641, à un inconnu nommé Hyperaspistes, on peut lire ceci : « Et dans la réponse aux Secondes Objections, j’ai dit qu’étant éclairés surnaturellement de Dieu, nous avions cette confiance, que les choses qui nous sont proposées à croire ont été révélées par lui, parce qu’en cet endroit-là il était question de la foi et non pas de la science humaine. Et je n’ai pas dit que, par la lumière de la grâce, nous connaissions clairement les mystères même de la foi (encore que je ne nie pas que cela se puisse faire), mais seulement que nous avions confiance qu’il faut les croire [6]. »
Dieu nous pourvoit en tout, mais surtout notre esprit auquel il apporte ses nourritures préférées. Dieu est l’instance sans laquelle aucune confiance de la pensée en elle-même ne serait possible. Nous sommes ici au cœur du paradoxe dont l’hyperbole est la traduction douloureuse.
L’esprit, la pensée, la conscience, le sujet, quel que soit le nom que l’on donne à l’instance qui cogite, ne se conçoit pas sans une soumission à une autre instance censée lui être favorable et qui doit être extérieure à elle et de l’action de laquelle elle tire la légitimité de son existence même. Dieu est le nom de la fonction qui relie, du dehors, les processus mentaux, psychiques et intellectuels et qui par ce geste constant d’assurance psychique rend possible le désarrimage de la pensée non pas tant du corps que des événements psychiques qui l’assaillent.
L’intériorité est le nom donné à l’insituable et indiscernable activité disruptive dans la pensée et qui ne cesse d’interdire cette « fiance » en elle-même que la pensée requiert pour ne pas désespérer de pouvoir continuer à « être ». La discontinuité est la marque de fabrique non tant de la folie que des manifestations psychiques qui brisent le continuum désirable et désiré sans lequel aucune assurance ne serait possible quant aux résultats obtenus par le « je pense ». Son extériorisation ou plutôt son externalisation est le seul recours possible permettant à une intériorité de se constituer. Mais elle ne se constitue que comme un espace ouvert bordé seulement par un ou quelques plis.
Il n’y a pas d’intériorité radicale et absolue, Leibniz l’a reconnu lui aussi. Simplement, on fait comme si l’on considérait que la source principale de la discontinuité psychique était sous contrôle ou du moins sans efficacité sur la continuité supposée assurée des processus mentaux et cognitifs.
L’histoire même de la pensée montre qu’il n’en est rien.

Discontinuité
Le véritable obstacle sinon à la pensée, du moins à l’assurance de sa possibilité et de sa pérennité, à la confiance qu’elle peut avoir en elle-même, c’est la discontinuité des processus qui la constitue comme des procédures qu’elle a inventées. Et sur cette discontinuité, on ne dit pas grand chose. Elle est pourtant au cœur même de la constitution de la forme sujet ou de la forme conscience, dans son sens développé de structure mentale et psychique permettant d’assurer à travers le jeu Je/Moi, le bon fonctionnement de l’orientation dans la double réalité du monde et des diverses productions mentales et psychiques auxquelles le sujet est précisément assujetti.
Car c’est en effet CONTRE ELLE, contre les effets déréalisants, que toute forme de discontinuité est censée produire sur un continuum rêvé, que le mythe de l’intériorité s’est constitué.
Une lecture attentive du livre de Richard Broxton Onians, Les origines de la pensée européenne [7] suffit à lui seul à permettre de saisir combien ce que l’on appelle la conscience, ou si l’on veut aussi la pensée subjective, et, partant, l’intériorité, est non seulement le fruit d’un long et douloureux apprentissage mais d’un combat indéfini contre cette interruption constante par des forces aux noms variables, des éléments que le psychisme tente de coordonner et des fonctions même de ce psychisme. Car rien n’a permis, on le constate chaque jour, d’abolir l’existence dans le fonctionnement mental de ces interruptions, ni non plus, le fait que, malgré elles, des formes de continuité aient pu être vérifiées et prises pour socle de développements nouveaux.
Le sujet cartésien est l’instance qui, inventée à partir du reflet ou de l’ombre projetée qui se manifeste dans l’énonciation du « je pense » et qu’il dit voir lui faire face, tente de considérer qu’elle a acquis une certaine autonomie, suffisante pour considérer qu’en elle s’est formé un pli, un creux, une poche et que ce creux, cette poche ou ce pli sont suffisamment extensibles pour accueillir sinon la totalité du savoir, du moins la certitude de la continuité de ses manifestations et garantir l’unité des fonctions de l’esprit.
La mémoire est un enjeu réel, mais la possibilité d’une continuité sans faille entre les souvenirs et les moments où ils se forment, entre connaissance et remémoration reste le point central autour duquel se constitue le dispositif cartésien.
Or, aucune instance « intérieure » ne peut en garantir l’existence et le bon fonctionnement, aucune. Et toujours, il faut faire appel à une instance qui se situe en dehors du sujet entendu cette fois comme corps-pensant ou si l’on veut corps-pensée. Descartes, pour des raisons conjoncturelles mais aussi philosophiques ne peut se passer de recourir à une instance supérieure à lui, mais il ne peut l’y loger en lui-même.
Elle doit donc loger ailleurs, c’est-à-dire dans le grand dehors qui n’est plus peuplé de monstres mais qui est à la fois, le paradoxe est connu, le domaine et du mystère et de la foi et en même temps la région dans laquelle la raison situe l’instance qui la légitime.
Un peu plus loin dans la même lettre, Descartes, confère à la puissance disruptive, par quoi se signe la discontinuité indéracinable qui agit dans le fonctionnement mental, le nom de passion. Il tente cependant de montrer que, rapportée à la puissance magique qui assure la continuité de tout dans l’univers, celle de l’instance existant dans le grand dehors, la crainte de la discontinuité n’a plus de raison d’être non seulement dans le « temps » mais aussi dans « l’espace ».
« Car j’avoue que je ne suis pas assez subtil pour pouvoir comprendre comment une chose peut souffrir d’une autre qui n’est point présente, et même qu’on peut supposer ne plus exister, si, par exemple, aussitôt que la toupie a reçu le coup de fouet, le fouet cessait d’être. Et je ne vois pas ce qui pourrait empêcher qu’on ne pût aussi pareillement dire qu’il n’y a plus maintenant d’actions dans le monde, mais que tout ce qui se fait est l’effet passif des premières actions qui ont été dès la création de l’univers. Pour moi j’ai toujours cru que l’action et la passion ne sont qu’une seule et même chose qui a donné deux noms différents, selon qu’elle est rapportée au terme d’où part l’action ou à celui où elle se termine et en qui elle est reçue ; en sorte qu’il répugne entièrement qu’il y ait durant le moindre moment une passion sans action... Et mes opinions ne nous jettent dans aucunes difficultés, mais seulement les conséquences qui en sont mal déduites : car je n’ai pas prouvé l’existence des choses matérielles de ce que leurs idées sont en nous, mais de ce qu’elles nous adviennent de telle sorte que nous avons conscience qu’elles ne sont pas faites par nous, mais qu’elles nous viennent d’ailleurs. [8] »
Et ainsi se reconduit, sous une forme renouvelée certes, mais encore et toujours articulant les dualités fonctionnelles du psychisme avec celles qui se déploient dans la pensée et qui se manifestent à travers l’infinité des partages duels qu’elle engendre, l’extériorisation nécessaire de l’instance assurant « l’orientation », la tendance à l’unification temporelle et spatiale, ou l’unité ce nom commun censé abolir ou réduire les risques inhérents à la discontinuité native toujours à l’œuvre dans le psychisme.
Notes
[1] Histoire de la folie à l’âge classique, Éditions Gallimard, Coll. Tel, p. 58.
[2] Dits et écrits, I, Éditions Gallimard, Coll. Quarto, p. 1134.
[3] Op. cit., p. 1163.
[4] L’écriture et la différence, Éditions du Seuil, p. 95.
[5] Op. cit., p. 96.
[6] Méditationsmétaphysiques, Éditions Garnier Flammarion, Paris, 1979, p. 490.
[7] Op. Cit., Éditions du Seuil, Paris, 1999, Cambridge University Press, 1951.
[8] Op. cit., p. 492.



